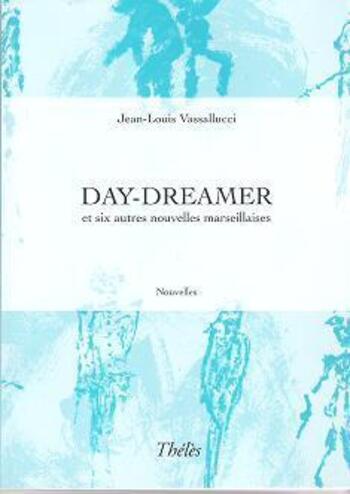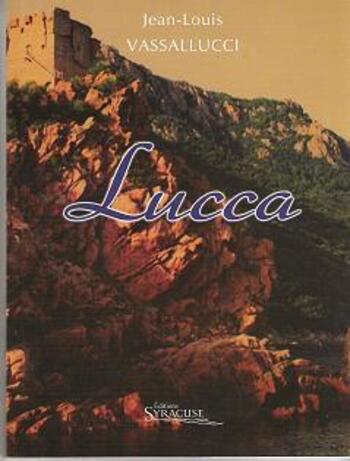-
Exercices de prédation <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
« Suis-je éveillé ou endormi ? Mais quelle différence ... ? Ou plutôt, sil y en avait une, à quoi la reconnaîtriez-vous ? Et sil y avait une différence reconnaissable, qui sen soucierait ? »<o:p></o:p>
<o:p>(Lawrence DURELL, « Nunquam »)</o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
1<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Un beau matin, je me lève. Je tends la main, le fond de lair est un peu frais. Je sors la tête. Et puis le cou. Bref, je me mets debout. Je me précipite chercher de leau pour arroser ma belle orchidée sur la fenêtre. Je larrose. Je réfléchis. Je pense à mon orchidée rouge qui dort dehors au mois de décembre. Je pense à moi aussi qui dois me mettre sur la pointe des pieds pour larroser. De là, je me hâte vers le garde-manger, en sors un bout de fromage de chèvre sec et un morceau de fougasse. Comme jai oublié denfiler un manteau en sortant du lit, je commence à grelotter. Je remédie à cet oubli et sautille sur place pour me réchauffer. Je sautille de plus en plus haut. Jarrive à la hauteur de la belle orchidée. Elle me salue et me remercie de lavoir arrosé tout à lheure. Je lui dis que cest tout naturel et retombe. Au saut daprès, elle me dit quaujourdhui elle voudrait se changer les idées en rendant visite à un ami. Je lui dis que cest impossible et retombe. Nous finissons par nous disputer et elle me traite de tyran ... <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Jai eu très peur quelle ne blesse quelquun en tombant de la fenêtre. Personne ne passait. Je suis descendu ramasser les morceaux du pot de terre et de lorchidée. Elle ma dit en mourant que cétait mieux ainsi. Je me suis mouché le nez et elle a rendu son âme à Dieu.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Faut-il lavouer, mais je me suis déguisé en femme. Avec un foulard sur les cheveux, du fond de teint et des talons hauts. Javais lair dune douce ménagère en quête dun peu de réconfort. Comme ça, je suis allé chez Louis, le fleuriste, acheter un pot de violettes. Elles nont rien dit. Arrivé chez moi, jai mis bas mon déguisement. Elles ont dabord été très surprises, puis se sont mises à crier. Jai tout essayé pour les rassurer. Je me suis remis le foulard et le fond de teint. Ca na pas marché. Elles ne se sont calmées quaprès que je sois sorti de la pièce. Je suis allé chez le cordonnier. Il ma prêté une paire de longs ciseaux. Jaime autant les bouquets de violettes ...<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Le lendemain, jai fait lacquisition de deux beaux poissons rouges et dun bocal rond. Jai posé le tout sur le rebord de la fenêtre, mais à lintérieur. Dehors, il y a un chat qui serait trop content de sen régaler. Jai donné un nom à chacun des deux poissons. Je narrive jamais à men souvenir. Pour les appeler, je tapote sur la paroi du bocal avec mes ongles. Je leur donne alors le premier nom qui me passe par la tête. Je ne suis pas sûr que ce ne soit jamais le même. Ca ne me gêne pas, mais eux semblent très contrariés de mes approximations. Ils ne peuvent bien sûr pas me dire ce quils en pensent, car les sons se propagent très mal dans leau et de toute façon ils ne sont pas bavards. Ils mexaspèrent même un peu avec leur discrétion. Je ne sais jamais ce quils pensent. Ils sont loin de mon orchidée qui connaissait par cur sa philosophie de Protagoras à Etiemble. Elle était aussi panthéiste. Elle aurait été néanmoins surprise de voir la piteuse métamorphose des poissons rouges durant leur cuisson. Ils changent de couleur et virent au marron clair. Leur chair est dailleurs très fade. Le regard du chat derrière la fenêtre nen fut pas moins plein de reproches quand, attablé avec une petite cérémonie, jai dégusté les petits poissons. Après, je me suis couché. Un bon sommeil réparateur mest tombé sur la tête. Je le sens, il est encore là.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
2<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Le matin, je me lève, ordonné et concis. Je me douche, me rase et mhabille. Carnet à tout noter et crayon dans la poche intérieure. Un peu dexercice et au boulot. Cest tous les matins la même histoire. Seul change le souvenir des rêves de la nuit. Je suis un homme qui rêve tous les matins quil dort et que ses rêves lemportent. Parfois, au fil dun rêve, je devine que je dors : ça me repose. Parfois, je crois me voir mort et ça minquiète. Ce matin, je me suis répété en me rasant : tu es un homme qui dort. Lorchidée mest revenue à lesprit, puis le bouquet de violette, le chat et les poissons rouges. Je me suis habillé et au boulot. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
3<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
En passant sur la Canebière, jai échafaudé une brève théorie qui explique la connaissance par lamour. Lamour que lon porte au monde. Après mure réflexion , la psychanalyse ma paru déjà susceptible de tout dire. Il marrive dabandonner. Jai essayé comme ça, à plusieurs reprises, dinventer un lieu où tout resterait à faire, tout serait à dire. Sans succès. Jaime mimaginer en penseur solitaire sous un ciel étoilé. Je vais masseoir sur le premier banc qui borde la bouche du métro Vieux Port, en sortant sur la droite. Je médite, un peu grave, sur le devenir ou le non-devenir de cette piteuse humanité. Un croquis. Deux croquis. Après ça, je pousse la promenade jusquà lOpéra. Le bel Opéra de Marseille autour duquel déambulent les péripatéticiennes ...<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Contrairement aux idées reçues, les belles de nuit marseillaises travaillent surtout de dix-huit heures à minuit. Quand les bureaux ferment et juste après que les gosses soient couchés. Je sais les observer sans trop me faire remarquer. Je minstalle sur les marches de lOpéra et me fais tout petit. Certains vont jusquà lancer hâtivement en mapercevant : « vé le petit nain ». Ils sont dans lerreur, je ne suis pas si petit en vérité. Mais je suis à la bonne hauteur pour regarder cette ville où rien ne se passe. Je ne parle pas de la routine qui vous emplit les yeux et les oreilles. De cet excès de répétition. Je parle de ce qui narrive jamais : que quelquun décide de sasseoir sur les marches de lOpéra pour observer le mouvement des péripatéticiennes au côté dun petit bonhomme ensommeillé. Là, vous avouerez quil advient à Marseille peu de choses de cet ordre. Et cest ce qui lui donne cet aspect funéraire qui flotte sur son agitation perpétuelle. Les gens petits y sont définitivement des nains.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Je dois souffrir dêtre incompris. Il faut dire quà la hâte bien peu de gens se comprennent. Il faut du temps pour y parvenir. Et le temps semble devoir échapper aux humains. Trop dincertitudes. Combien de temps dure un rêve ? Et qui veut sen souvenir ? Beaucoup pensent que les rêves sont voués à seffacer au réveil et que les rêves du lendemain ne sannoncent pas. Cest autant de bonnes raisons pour les remplacer par du sens commun. Autant dire tout de suite quavec ma taille je ne peux pas aimer le sens commun. Cest une sorte de planification des dires et des pensers qui me navre. Je me dis que je pourrais être noir, venir de loin et nêtre pas grand. Jentendrais souvent « vé le petit pygmée ». Tout me sauterait aux yeux. Ce serait le seul avantage que me conférerait mon extranéité exotique : le recul. Je me dirais « en Afrique, tu étais tout commun, tout vulgaire, tout plein de bonnes paroles banales et ici tu es tout simplement un petit pygmée ». Même les prostituées ne voudraient pas de moi. Je serais tout extérieur à ce monde. Mais là, jextrapole. Je prends du recul quand même.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Je voulais devenir philosophe, plutôt quartiste à tout faire. Jaurais eu un regard figé superbe. Que le monde prenne si peu de sens nouveau maurait toutefois condamné à répéter. Je laurais craint. Hormis quune prostituée ne veuille pas de moi, rien ne me fais plus de peine. « Tu me fais de la peine, Marius ! » suis-je encore capable de lâcher quand lautre me jette un regard mauvais. Mais cest pure formalité. Je sais voler chaque jour mon petit bonheur aux humains. Je récolte même quelques sous que, les soirs de spectacle, les bourgeois en se baissant me déposent au creux de la main. Presque plus rien ne me vexe, disais-je. Jai appris à prendre du plaisir dans la rencontre fortuite de quelque illade fugitive. En bref, à nicher mon regard dabord sur les poitrines de belles dames accompagnées au sortir du concert, à cette hauteur où brillent fort les colliers, puis à remonter jusquà croiser leurs yeux, quelquefois superbes, quelquefois ahuris.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
« Gardez la femme! », ai-je souvent envie de crier. « Je ne prendrai que ses yeux et la rivière de diamants ». A ce moment là, immanquablement, sous prétexte de contrôler mon identité, un agent de police sapproche et me met un coup de pieds dans le tibia. Ensuite, très souvent, il investigue mes mobiles et menjoint de circuler. Et plus vite que ça.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Je nai rien contre la police. Elle est, dans lOrdre des choses, aussi naturelle que le mouvement perpétuel des employés de banque, des marchands de chichis à lEstaque ou des horloges solaires. Elle ne se montre finalement incompatible quavec les tibias des petits blancs. Ou pire, des petits noirs. Je pourrais me faire amputer des deux jambes et aller, cul de jatte, sur le parvis des églises régaler mon regard des dessous des bigotes. Mais la religion se perd et elles sont toutes vieilles. Je regretterais ma place à lOpéra. Et puis, je nen serais pas moins tout noir dans ma tête. Solidaire du monde des pygmées. Même la philosophie naurait su me sortir dune telle impasse. Aussi, plus le temps passe, moins le sort de mes tibias me préoccupe. Mieux jaccepte dêtre noir dans la tête. Ce que le philosophe toujours tâtonnant dans lobscurité métaphysique recherche et ne sait pas trouver, cest peut être le Nègre suprême. Celui qui, assis sur les marche dun vaste Opéra par une nuit sans courant électrique, observe le carnaval humain en toute impunité. En attendant la nuit orgasmique où le cosmos tout entier et déshabillé prendra violemment conscience quil est observé par quelque chose comme un Nègre suprême, je métends et je rêve.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
4<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Aujourdhui, je naurais voulu pour rien au monde être ailleurs quà Marseille, assis sur les marches de lOpéra. Une créature magnifique est venue me demander du feu. Je lui ai donné celui de mes yeux. Elle est allée ensuite prendre place à langle de la rue, une jambe ballante, talon contre le mur, le bras controlatéral ballant aussi pour caresser une jambe infinie et porteuse de lensemble, alors que du bras opposé elle tenait un sac de cuir et de dorures contre ses hanches ...<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Et ne croyez surtout pas que je ne suis quun vulgaire voyeur. Les prostituées nont en vérité, pour moi, quun intérêt secondaire. Dun certain point de vue, leur conduite fout même à leau un certain nombre de mes théories. Je parviens dailleurs rarement à accrocher mes rêves sur elles. Sauf à parler bordels magiques et enluminures. Sauf à prêter de la magie au spectacle. Jai trop, en ce moment, tendance à stigmatiser le triste état de la condition dêtre-au-monde pour jouer le jeu. Je nai pas toujours été comme ça.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Je disais tout à lheure que les prostituées sont en mesure dinfirmer en partie certaines de mes théories. Comment expliquer leur propre abstraction quant aux choses du corps ? Leur logique marque-t-elle un recul conscient sur la bonne ordonnance de la vie marseillaise ? Jai du mal à souscrire à lidée dEngels que vendre son cul est plus révolutionnaire que vendre sa force de travail. Et pourtant ...<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Jai écrit sur un tout petit bout de carton après que la très belle du coin soit partie avec un client : « Vous remarquerez quil y a en lambeaux - sous les arbres - dont la majesté calme toujours les âmes en peine - souvent un corps dévêtu - échappé encore trop jeune pour avoir su parler - et na pas entendu la beauté de ce chant - où sinscrivent tout doux - dans un immense sourire - les dents pleines de chair ». Petite méditation et au dodo.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
5<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tout se précipitait. Je me grattais le menton. Sourire énigmatique de héros à la commissure des lèvres. Je décidais de ne pas prendre le dernier verre que ce brave Marius me tendait pour la route. Je me retrouvais hors du bar quelques instants plus tard. Assez fier de moi. Je ne sais pas vraiment résister à lalcool, mais je naime pas que lon me force la main. Jinclinais un peu ma casquette de bouliste. Comme ça, javais lair encore plus redoutable. Je traversais dun pas décidé les rues étroites du Panier. Détour volontaire par la place des Moulins à la nuit tombante. Il faisait doux pour un soir de décembre. Je nallais pas être déçu de la promenade. Quelques sensations fortes sannonçaient au coin de la rue. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Je ne pus mempêcher de frémir en apercevant la fille. Je devrais dire en la scrutant. Elle me demanda naturellement du feu. Je nen avais pas en poche. Je lui proposai sans hésiter de visiter le jardin qui jouxte mon chez-moi. Je fis avec les bras plusieurs cercles dans lair pour bien lui dire le feu denfer quelle trouverait dans latelier là-haut sous les toits, après le jardin. Cétait beaucoup anticiper. Néanmoins, de bonne grâce, elle me suivit. Petits regards coquins et investigations discrètes. En marchant, jen déduisais rapidement quelle en savait beaucoup. Beaucoup plus quune inconnue de passage. Son intérêt pour les banalités que je lui débités était trop ouvertement feint. Quelle idée avait-elle derrière la tête ? Jentamais avec elle un jeu subtil de mensonges et de sous-entendus. Elle prenait une mine de plus en plus candide. Allais-je devoir me ruer sur elle et la mettre hors d état de me nuire ?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Cette nuit là, je fus extrêmement gêné. Accroupi au fond du jardin qui jouxte mon chez-moi, je mappliquais à découper un corps de femme. Penché à sa fenêtre, mon voisin observait la scène. Ca me mettait mal à laise. Il faisait de plus en plus tiède et cette curiosité malsaine me révulsait. Ma besogne finie, je creusai péniblement un trou afin dy mettre les morceaux. Le voisin ferma ses volets. Sans doute pour aller se coucher. Jen fis autant.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Le matin, je fis mon petit tour sur le Vieux Port. Tranquille. Détendu. Une halte à la terrasse du Grand Café. Jappelai Jeannot, le garçon. Je lui dis, comme dhabitude, « oh Jeannot, tu me lamènes ce petit noir ... ». Un hochement de tête endormi comme seule réponse, puis vint mon café. Ce Jeannot là nest pas bavard. Cest un grand discret. Je ne laurais pas reconnu hors de sa terrasse. Jobservai aussi les pigeons. Parfois, jai limpression dapprendre un je ne sais quoi dessentiel en les regardant. Jai avalé le petit noir et au boulot.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
6<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
En ce moment, je donne dans la poésie tragique. Parce que je suis en deuil. Dordinaire, je fais exclusivement de la sculpture monumentale. Ca remplit mes journées et latelier. Je sors de plus en plus souvent pour respirer et je ne laisse quasiment plus entrer personne. Jai dailleurs affiché le texte qui suit sur ma porte : « Ô schéma de la prédation ! Lumière intérieure et brasier nocturne. Ô porte flammes, montre moi le chemin. Intercède en ma faveur auprès du destin trop rapide de lhumanité. Rends moi mes ailes. Aide moi, dans ce monde de limaces et de foetus impatients, à retrouver les forces de lau-delà, de lavant et de laprès, de la tempête cosmique et de ses avatars. Aide moi à me libérer et ton prix sera le mien. Léternité dans léther mimporte peu. Ô prédateur de la nuit, ordonne aux vents de souffler ». Le jours où jai accroché ça au-dehors, jai été soulagé. Les autres napprécient pas le contenu.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Une belle de nuit qui avait lu le texte avant dentrer ma même fait une crise dasthme. Elle sest recroquevillée sur elle-même dans un coin de latelier. Puis, elle sest mise à haleter en murmurant, la tête entre les jambes. Je me suis assis à ses côtés et elle ma dit quil était là. Que Lucifer en personne sétait déplacé. Que son souffle parcourait la pièce. Et quelle entendait un grognement monter des ténèbres. La chaleur devint suffocante et elle sévanouit. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
7<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Pourquoi pas ? Une mère, cest sacré ! Cette fois, jallais tordre le cou à Louis, le fleuriste de la Plaine. Il avait mis sa mère en maison de repos. Là où il ne restait plus aux vieux quà bailler et mourir. Je la voyais, sa mère, sortir sur le pas de sa porte et appeler « Lll-ou-iii... ». Elle avait toujours eu un petit ventre qui remontait sous ses seins quand elle inspirait et qui retombait très bas quand elle lâchait son « Lll-ou-iii... ». La veille, il lavait chargée dans sa camionnette. Toute maquillée. Le bel ensemble et le collier de perles de culture. Il lui avait dit quelle allait se reposer à la campagne. Elle qui navait jamais pris le temps de se reposer, ni à la campagne, ni ailleurs.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Quest-ce que je viens faire dans cette histoire ? Louis dit que ce nest pas la mienne et quil ny a plus assez de place chez lui. Un point, cest tout. Même la coiffeuse, celle qui a appelé son magasin « Quoi ? Feuze », ma dit que je ny pourrai rien. Quoi ? Il faut que je men tienne à ma casquette de bouliste ? Que je disserte sur ma casquette blanche qui, à Marseille, ne fait pas si mauvais genre ? Car oui, ma casquette fait artiste. Alors là, je massois sur un banc. Je souffle un bon coup. Je remonte la casquette pour massurer un joli champ de vision; ça me dégage le front. Et quest-ce quil se passe ? Il se met à pleuvoir. Ma casquette, je la porte enfoncée jusquau nez, pour quon comprenne bien qui je suis.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Je préfère me coucher et ne plus rien savoir. Des journées comme celle là, ce nest pas fait pour me mettre en forme. Il y a quelque part quelque chose qui bloque. Moi, ma casquette blanche, je ne labandonnerai jamais. Louis, tiens toi le pour dit. Je me sers dabord un Gambetta, enfile un semblant de pyjama et métale sur le lit. Je pense à Louis qui ira se soulager à la messe en latin. Il fera un peu pénitence. Le problème sera vite évacué. Il aime bien les contenants, Louis. Sa mère dans un bel aquarium. Cest plus quil ne lui en faut pour sabsoudre. Jéteins le lumière. Et mendors. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
8<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Une après-midi de sel se préparait. On sentait la tempête se déployer sur Marseille. Cétait de bon augure. Rien ne maurait plus inquiété aujourdhui que daffronter seul la banalité des apparences. Lapparence des gens. Des choses. De la ville toute entière. Levé trop tôt ce matin, après mon petit tour de quartier, je suis surtout resté étendu sur le canapé. Jai un peu lu Lao Tseu appuyé contre létagère branlante de la bibliothèque. Et jai fini par taper quelque coups de ciseau dans un buste de femme à cornes. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
9<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Il y eut un tonnerre derrière la colline, puis ce fut grandiose. Apparurent dimmenses oiseaux bleus, suivis dinnombrables petits gris et dune troupe fauve de beaux animaux à fourrure. Cétait le lâcher du gibier pour la chasse. Hé ! Louis, arrêtes de te demander lequel tu vas esquagasser et tire ! Nom de Dieu ! Je venais de placer le canon de mon fusil sur la tempe de la perdrix, qui eut tôt fait de comprendre ce qui la menaçait. Elle esquiva. Javais bien failli me mettre dix grammes de chevrotine sur les pieds. La prochaine, je laurai à larme blanche.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ce Louis, cest mon grand ami, mais cest vraiment un bon à rien. On avait commencé très tôt à le lui dire. Vers cinq ans, sa grand-mère lui répétait « nage, nage, tu vas nager ! » et elle essayait de le traîner jusquà leau. Lui, il ne voulait rien entendre. Il senracinait dans le sable. La grand-mère finissait par lâcher prise en lui criant « bon à rien, regarde les autres enfants comme ils nagent, comme ils sont beaux et quils font plaisir à leur mémé ». Sa grand-mère, elle était morte depuis longtemps, mais il laimait encore beaucoup. Il ne savait toujours pas nager. Cela navait plus aucune importance pour personne. Dailleurs, il ne savait pas faire grand chose et tout le monde sen fichait. Javais fini par égorger deux perdrix. Louis navait pas été fichu dajuster un faisan qui lavait reconnu et venait manger dans sa main. Ce faisan, avec quelques autres, cest lui qui lavait charrié jusquau terrain de chasse. Alors ...<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
10<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Le soir, je suis monté par le flanc de la colline jusquà la Bonne Mère. En entrant dans la chapelle, jai cherché un bénitier qui ne soit pas vide. Jai fait un signe de croix. Je le fais parfois très bien. Je soupire en même temps. Cette eau bénite sentait un peu le pipi. Jaime bien aussi les vaisseaux de guerre en bois pendus au plafond de la chapelle. Ils rappellent que les Outre-Atlantiques eux-aussi sont passés par là, juste après les Germaniques. On dit que les Outre-Atlantiques sont des gens très pieux. Je les aime bien quand même. Nessayez pas de me parler des Germaniques. Jai brûlé un petit cierge en pensant aux Outre-Atlantiques et à la mère de Louis. Et je me suis assis sur un petit banc. Exceptionnellement, jai dévissé ma casquette de bouliste. Tout ce silence.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Quand on mappelle « mon petit », je ne réponds pas. Je toise. Je méprise. Jai voulu me confesser. Pas moyen de trouver une oreille assermentée. Jai bien aperçu un curé. Trop nerveux. Il sest précipité sur un couple damants collés-collés dans un coin de la chapelle. Lamant avait la main déployée sur sa poitrine généreuse à elle. Le curé, arrivé par derrière, avait crispé ses doigts sur son épaule à lui. Il avait invoqué le Christ, mort sur la croix, et tout était rapidement rentré dans lordre. Les mains dans les poches et les deux gros seins dans le soutien-gorge. Moi je métais levé pour linterpeller, mais il se pressait déjà vers un autre couple en émoi. Javais bien essayé de respectueusement le héler, mais il mavait lancé, en accélérant : « une minute, mon petit ». Je suis redescendu un peu en colère. Du coup, jenvisageais de commettre illico de multiples actes de chair.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
11<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
On clame trop peu souvent haut et fort ses propres mérites. Il ne faut surtout pas y croire. Mais ça décontracte. Je suis donc moins grand que dautres, mais très bien de ma personne. Dans la logique des raconteurs dhistoires, quand on dit « patati patata mais bidule truc », cela signifie « certes patati patata est important, mais mais mais bidule truc lest plus encore ... ». Alors, je plais. Jai les oreilles un peu grosses, mais je les recouvre avec ma casquette dartiste marseillais. Ce que jen dis aussi, surtout aux belles curieuses, cest quelles témoignent de mon aptitude naturelle à jouir de lharmonie des sons. Mon nez est assez long, mes lèvres fines et mon front étroit. Bref, la nature ne sest pas montrée trop avare avec moi.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Quand jai quelques doutes et que les « mais » ne suffisent pas, je mets le cap sur lOpéra. Je me peigne. Me rase. Enfile des chaussures à talons. Ajuste ma casquette. Un alcool fort pour la route. Et vogue la galère. Cest que je suis, comme qui dirait, un artiste courageux et mélomane. De chez Lucienne, ma libellule du samedi soir, on entend aussi bien quà lorchestre et on peut se mettre à laise.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
12<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Jules, cest le frère de Louis. Il fait ses trente neuf heures par semaine comme agent de police. Pas les gardes mobiles, mais la police urbaine. La police tranquille. Un jour, il a eu lextrême amabilité de minviter à un interrogatoire. Comme ce nest pas légal, cest réservé aux amis. Cétait linterrogatoire dun petit Oriental. Un nouvel arrivant à Marseille. Cest mieux que rien. Juste un petit Oriental suspecté davoir emprunté une bicyclette. Comme beaucoup de petits Orientaux.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
On ne lui avait pas attaché les mains dans le dos. Pour bien dire quà Marseille la police ne sinspire plus des méthodes des Germaniques. On lui a même donné un chocolat. Et puis une gifle. Et un coup de pieds dans les tibias. Il avait dit à Jules quelque chose dagressif en oriental. Ce qui nétait pas très élégant vis à vis de Jules. En rien polyglotte. Cela avait amené Jules à le corriger à nouveau. Et ainsi de suite. Finalement, on lavait relâché faute de preuves. On ne voyait plus que cétait un petit Oriental. Il était bleu-vert sur tout le visage et sur les tibias. Sa grande sur lavait attendu dehors. Elle lavait reconnu à ses belles chaussures cirées et à ses petits yeux noirs. Elle avait hurlé en le voyant. Elle naimait certainement pas le bleu-vert. Couleur martiale.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Furieuse la grande sur. Noire et souple comme une panthère. Elle avait pris le petit dans ses bras en lui parlant oriental. Il pleurait. Pour le consoler, on avait bien compris quelle lui promettait darracher quelques paires dyeux de flics. A ce moment là, cet imbécile de Jules aurait bien sacrifié son iris glauque pour perquisitionner sa chute de reins. Dans les jours qui suivirent, tous les flics du quartier décidèrent de porter des lunettes noires. Jules aussi. Il réussit quand même à en convaincre quelques uns dinviter la jeune fille à visiter larrière-boutique du commissariat. Ce qui fut fait.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
13<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Cétait le mois de Noël. Je sortais de mon atelier. Le couloir sombre sentait la routine mortuaire. Comme dans mes plus mauvais rêves. Jerrais dans les rues à grands pas. Ma gabardine sombre allongeait exagérément mon ombre de prédateur. Je marchais à la recherche dune proie. Mon regard noir en disait long. Je gardais la bouche entrouverte pour laisser voir mes canines. Le rictus ne trompait pas. Ce soir, jétais sans doute lêtre le plus extraordinairement cynique qui se put rencontrer à une heure aussi peu avancée dans les rues de Marseille. Lucifer sétait peut être arrêté devant ma porte et le texte affiché lui avait plu. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Jaurais voulu avoir les doigts longs et osseux dun vampire. Jen avais déjà lappétit. Un couple de bourgeois en ballade nocturne avait changé de trottoir en mapercevant. Je sentais combien ce soir je traînais une aura surnaturelle. Et que les simples mortels, ni artistes, ni rien, ne pouvaient quêtre pris de terreur en mapercevant. Jétais dune présence si intensément inhumaine que mon ombre déplacée sur le sol par les réverbères me causait une soudaine angoisse.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Je commençais à ressentir lourdement la fatigue de la marche forcée. Il ny aurait peut être rien pour moi ce soir. Cest lil plein de brume et la jambe pesante que japerçus enfin ma victime. Cétait une splendide créature. De longs cheveux tressés. Agée tout au plus dune vingtaine dannées. Elle fut prise, comme prévu, dune terreur violente quand jarrivais par derrière pour lui sauter au cou. Sa course était désordonnée mais rapide. Elle sasphyxiait sans pouvoir appeler. Moi, javais bien du mal à prendre le rythme. Elle alla finalement se perdre au fond dune impasse, où mon sombre office fut expédié. Elle poussa un cri aiguë avant que je ne létende suffoquée dans le caniveau. Le gars qui faisait mine de promener son chien me jeta un regard méprisant. Il avait si patiemment attendu que jabuse delle. Ce nétait pas mon genre. Une vieille, sans doute propriétaire de limpasse, me cracha dessus de son balcon. Elle maugréa que maintenant le corps encombrait le passage. Je croisais encore quelques regards réprobateurs ou déçus avant que dans mon repli les ruelles de la Plaine ne moffrent leur protection.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ce coup là, jétais épuisé. Je navais même pas eu le cur de la couper en morceaux. Javais aussi un cor au pied. Je fis, dans la nuit qui suivit, un beau rêve doré. Jétais dans les bras de la Bonne Mère. Elle me berçait. Me dorlotait. Je tenais amoureusement un gros uf de Pâques. Je le dégustais lentement en le brisant avec méthode. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
***
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 votre commentaire
votre commentaire
-
Chapitre 9 A Rosazia<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Arrivés en début de matinée au hameau de Rosazia, les frères du brouillard sétaient arrêtés devant la demeure du Stregu. Une vaste maison de pierres grises. Avare en ouvertures sur la façade principale. Des murs aveugles au Nord et à lEst, dos aux vents des montagnes. Une masse lourde et carrée, solide comme une tour génoise. Quelques dépendances autour. Une maison inspirant la sobriété le jour et un néant dhumanité la nuit.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ce 23 septembre 1798 sannonçait une journée de pénombre et de repos pour la troupe des hommes en noir. Les abords de la maison du Stregu étaient déserts. Comme lensemble du hameau. Rien dinhabituel au demeurant. Chacun saffairait à des tâches dintendance. Amenait sa monture aux écuries. Séchait les chevaux. Les soulageait de leurs selles et harnais. Des bagages et des armes. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
La porte du Stregu ne sétant pas ouverte delle-même, les frères préféraient attendre patiemment quil se manifeste. On ne dérangeait pas le sorcier de Rosazia. On le provoquait encore moins, sauf à chercher la mort. Et se signaler à son attention, devant sa propre demeure, eut été pour le moins un affront à son acuité et à son omniscience revendiquée. Les frères du brouillard se regroupèrent donc au fond de la plus spacieuse des écuries. Le vénérable Ettore Lupini souhaitait mettre au point les derniers détails techniques de leur opération. Des détails que chacun savait émis sous réserve des recommandations que leur ferait le sorcier.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Le Stregu de Rosazia demeurait enfermé dans son cabinet de travail. Un bureau ordonné. Sans alambics, ni chouettes empaillées ou bocaux donguents visqueux. Des portraits aux murs. Des ancêtres sévères. Des maîtres dallures dogmatiques. Et des étagères couvertes dencyclopédies, de livres de belle facture et peut être de quelques grimoires. Une pièce sobre, à limage de la bâtisse. En définitive, un lieu semblable à bien des cabinets de vieux notaires ou dérudits versés dans les sciences apothicaires. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
La tournure donnée aux événements par la confrérie du brouillard le préoccupait sans quil sache pourquoi. Ce sartenais, dune intelligence rare et portant avec prestance sa soixantaine dannées, dédaignait les êtres petits et les situations bancales. Il sétait élevé très au-dessus du commun des mortels, en partie pour ne jamais se trouver enfermé dans de médiocres obligations. Ce manque presque inédit de discernement le troublait intimement. Il sentait son devenir lié aux événements en train de se tisser, mais ne parvenait pas à en détecter les causes. Et encore moins les remèdes. Que les hommes en noir ne voient que dun il leur entreprise lui déplaisait fortement. Un stregu ne se contentait jamais de calculs à courte vue. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Quels grands équilibres seraient bientôt mis à lépreuve par la confrérie ? Quelles conséquences attendre dun affrontement frontal avec Renata, la Magga du Monte dOro, y compris sils parvenaient à la vaincre ? Au-delà de la Magga, les forces de la Miséricorde, qui avaient amenée la fille de Bocognano à une vie de dévouement et de patience, ne seraient-elles pas heurtées au point de faire entorse à leur sacro-sainte réserve ? Les anges navaient-ils pas déjà montré quils étaient capables dentrer dans de justes et dévastatrices colères ? Le Stregu se sentait au faîte de sa puissance. Tomber de si haut ne le tentait guère.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Avant de recevoir les frères de la loge du Sorru, il lui fallait impérativement retrouver toute sa clairvoyance. Il sembla sagiter. Des trombes deau, projetées avec force par le vent, lempêchaient de se concentrer. Seul un rituel suprême le sortirait de son malaise. Il tira les volets. Alluma un cierge bleu nuit. Et sortit un petit coffre argenté dune armoire. Dans lobscurité de la pièce, les bruits de lextérieur avaient disparus. Le Stregu se sentait à nouveau lui-même. Dominant sur la matière. Souverain sur les esprits faibles.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Il tourna le dos à lOrient. Ouvrit le coffre. En tira des objets quil plaça rapidement sur une petite table. Sept bâtons dencens aux senteurs de vanille et un bol quil remplit deau. Avec la chandelle, il alluma lencens. Prit ensuite le bol, quil présenta à hauteur de son visage. Ses yeux se reflétaient sur leau et vice versa. Un silence. Une respiration profonde et lente. Des mots séchappaient de ses lèvres. Psalmodiés avec gravité.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
« Gardien de lOuest et des métamorphoses de leau. Puissant L., intercède en ma faveur. Déchire la frontière des mondes invisible et visible. Place-moi au confluent de lavant et de laprès. Disperse lerrance grouillante des élémentaux. Fais de ce couloir un poste dobservation où puisse se tenir ton serviteur fidèle. Je dénouerai les fils de la vie, jusquaux reflets des âmes. Je capterai la volonté des ténèbres. Le fruit de mes forfaits sera partagé avec Toi » <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A lissue de sa transe, le Stregu connaissait le dessein des hommes en noir. La pérennité de leur pouvoir. La série toujours plus longue des richesses et des succès de leurs chefs. Lexil de lexistence du petit Tucci, par la mort ou le bannissement de la terre corse, loin de la destinée de la confrérie. Les faits allaient, à lévidence, méthodiquement donner raison aux frères du brouillard. Dès aujourdhui et à toutes les époques. Leur organisation, leur puissance temporelle et leur détermination ne rencontreraient que de faibles oppositions physiques. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Leur avenir, aussi loin que le Stregu avait été autorisé à se projeter, témoignait de leur capacité à se répandre dans la société corse et bien au-delà. Les inclinaisons humaines, lhypocrisie et le lucre, ayant un avenir modelé par la physique terrestre, qui tire tout objet vers le bas, le Stregu voyait la confrérie finir par dominer le Monde. Personne, mieux queux, ne saurait agglomérer la diversité des humains dans une aussi universelle fraternité dintérêt. Tout cela confirma au sorcier que son alliance était la bonne. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Avant de sortir de son cabinet, le Stregu eut comme un embarras. Une gêne fugitive. A son corps défendant, il pensa au Divin. Presque machinalement, il sagenouilla. Une larme infime perla, malgré lui, sous sa paupière gauche Bien que les âmes soient devenues pour lui de simples friandises, il ne doutait ni de lexistence, ni de lomniprésence du Divin. Seulement, il le savait dans une posture diffuse. Trop souvent inaudible ou enclin à se taire. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Plus que quiconque, le Stregu de Rosazia aurait pu témoigner que londe divine emplissait bien lunivers jusquau dernier recoin de la Corse. Mais elle se complaisait surtout, selon lui, à observer lélégante ronde des êtres de lumière. Eux seuls paraissaient avoir le privilège dune écoute attentive. Aux autres, sa bienveillante indifférence ne consentait de récompenses que fortuites ou par dinvraisemblables péripéties. Rien dajustable ou daisément maîtrisable. De retour de ses excursions métaphysiques, le Stregu se lamentait souvent en son fort intérieur que tant de puissance sans a priori sapparentait à un gigantesque gâchis. Aux lèvres de lhomme de désirs et dappétits féroces, la passivité du Bien avait le goût insipide dun insupportable vide.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Il glissa avec aisance jusquau bas de lescalier. Après avoir traversé un vaste salon, il ouvrit sa porte aux hommes en noir. « Entrez, mes frères ! Un déjeuner de viandes rouges, de vin du Cap et de pain frais vous attend. Votre entreprise, comme la plupart des précédentes, sera couronnée de succès. Ce qui ma été montré est sans appel. Quimporte le prix à payer. Probablement des revers de conjoncture et quelques vies écourtées, dont celles de plusieurs de nos frères. Votre pouvoir temporel ne sait que croître et se diffuser dans la sphère humaine. Alors mangeons et buvons tout notre saoul !», semporta le Stregu, dhabitude plus sibyllin.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Le repas fut néanmoins tout juste cordial, presque policé. Quand les frères de la loge du Sorru se trouvaient tous réunis, comme là, certains aimaient pourtant se donner en spectacle et se montrer rigolards. Hélas, limpassibilité retrouvée du Stregu favorisait surtout le silence et lobservation dautrui. Des signes discrets et quelques mots à voix basse séchangeaient quand même entre ces hommes ayant généralement dans le civil de la tenue et du savoir-vivre. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Seul Boezu Lupini voulut apporter sa touche dérogatoire au climat compassé entretenu par ses compagnons. Dabord modérément remuant, il finit par faire tâche au milieu des autres. Trouvant cette singularité épaisse bien à son goût, il lança de petits clins dil au Stregu. Son champ de vision fixant les limites de sa conception du monde, il ne craignait tout au plus que la cruauté du sorcier. Rien de très extraordinaire à ses yeux, si ce nétaient lexpertise et la notoriété du Stregu de Rosazia en la matière. Ses transes et ses pouvoirs sur linvisible ne valaient, pour Boezu, que par lhabileté du sorcier à se mettre en scène. Une bonne connaissance de la bêtise humaine. Une aptitude exceptionnelle à lire le climat et les signes de la nature.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Habitué à la retenue du Stregu, le frère du vénérable, manifestait une présence quelque peu encombrante pour toute la loge. Nen pouvant plus de sentir des regards passablement réprobateurs, il se lança. « Sorcier, nous accompagneras-tu au combat cette fois ? ». Puis sur un ton de défi : « Ton brouillard qui traîne partout et tes visions dalambics nous sont dune aide précieuse. Mais peut être aurais-tu dautres tours à nous montrer ? Et pourquoi pas un sabre à la main ? ». Le Stregu ne le regarda pas. De longues minutes de silence sinstallèrent, permettant à Boezu de chercher dautres idées.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A la surprise manifeste des frères du brouillard, le sorcier confirma quil les accompagnerait à leur partie de chasse. Il serait là pour porter au gibier le coup de grâce. Puis, en sadressant au vénérable Ettore Lupini, il reprit paisiblement, « les plus éclatantes victoires sont aussi des défaites. Tout a un prix, prélevé à lombre des marches triomphantes. Je ne sais pas avec précision quel sera réellement celui du projet qui nous occupe. En étant à vos côtés, jen tiendrai les comptes. Les forces des ténèbres annoncent rarement par avance les tributs quelles prélèvent. Jobserverai, pour la richesse de lenseignement ».<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Boezu se dit avec modestie quil venait de forcer le Stregu de Rosazia à sortir de sa tanière et à respirer la poussière des chemins aux côtés des frères de la loge. Porté par une petite euphorie, il voulut pousser plus loin lavantage. « Sil ny avait pas eu ce maudit Génois, nous naurions payé aucun prix pour tout ce que nous avons bâti. Notre construction est indestructible. Nous sommes de plus en plus nombreux et le butin partagé saccroît sans cesse. Les confréries qui sinstallent nous prennent en exemple et nous font allégeance. Si tu nous gardes seulement du mauvais il, nous ne connaîtrons aucune défaite dans les jours qui viennent ! ».<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Le Stregu se dressa calmement. Son repas était terminé. Ses hôtes pouvaient prendre leur temps et réclamer à son domestique tout ce qui leur plairait. Maintenant, il souhaitait se retirer. Tout au plus, sur le ton pacifique quil affectionnait pour annoncer les morts violentes, eut-il une dernière attention pour Boezu : « si le futur proche est tel quil ma été donné de le voir, un frère du brouillard dont le masque dissimule un visage semblable au tien nous quittera bientôt ».<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Quand le sorcier eut quitté la pièce, toute la loge du Sorru fit avec les mains des cornes et des signes de conjuration. Boezu prit les choses différemment. Le Stregu de Rosazia venait de souhaiter quil se fasse tuer devant ses frères en loge. Lavanie méritait un sanglant remboursement. Il sen souviendrait en temps utiles. Selon lui, la confrérie aurait pu se passer depuis longtemps de cet appui immatériel. Son vénérable de frère sentêtait à chercher des prolongements impalpables à des situations bien concrètes. Le mot escroquerie, lui vint à lesprit. Il en était convaincu, les simulacres de spiritualité de la confrérie, destinés à habiller sa volonté de puissance, nourrissaient un escroc déguisé en sorcier.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Après cet incident, les frères du brouillard retournèrent vers la paille des écuries pour sy reposer. Les lagramenti qui, par prudence, nentraient jamais dans la demeure du terrible Stregu, reprirent possession de commensaux quelque peu anxieux. Gavés aussi par le repas du sorcier. Parfois jusquà la nausée. Agacés, ils décidèrent de les tarabuster en leur rappelant des souvenirs de traques nocturnes. Quelques images de cauchemars. De mises en scènes mortuaires. Sentant les hommes en noir regagner leurs pénates, ils se firent joueurs en stimulant les petits rêves personnels de chaque frère. Et tout rentra dans lordre.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
***<o:p></o:p>
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires